PLUSIEURS PRINCIPES OPPORTUNS AUJOURD’HUI
13Aug
1.Les articles de foi ne changent pas de sens avec le temps et les époques, mais signifient toujours les mêmes vérités (serment antimoderniste, Ds 3541).
2.La vertu de foi n’est pas un sentiment religieux naturel ou le fruit d’une réflexion de l’esprit, mais un assentiment surnaturel de l’intelligence à la vérité reçue de Dieu par l’intermédiaire de la prédication extérieure (serment antimoderniste, Ds 3542).
3.C’est un dogme de foi que l’existence de Dieu, créateur de toutes choses, peut être démontrée avec certitude grâce à la lumière naturelle de la raison (concile du Vatican, Ds 3026).
4.Il est certain que la seule véritable Église du Christ est l’Église catholique romaine (Pelage II, Ds 468). C’est en outre un dogme de foi que l’appartenance à l’Église catholique est nécessaire au salut de tout homme (IVe concile de Latran, Ds 802). Est suspecte d’hérésie la proposition suivante de Vatican II : “L’Esprit du Christ ne refuse pas de se servir des autres Eglises et communautés ecclésiales séparées comme moyen de salut, dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l’Église catholique (Unitatis redintegratio, chap. I, n° 3).
5.Inviter quelqu’un au culte d’une religion non catholique est toujours matière à une faute de même nature que ce culte et à un scandale — qui blesse la charité. C’est encore vrai si le souverain pontife fait cette invitation, même lorsqu’il est motivé par l’intention de promouvoir la paix dans le monde (Pie XI, Mortalium animos. R.P. Merkelbach, Summa theologiae moraliae Paris, Desclée de Brouwer, 1938, t. I, § 963).
6.C’est un dogme de foi que tout homme — à l’exception de la Vierge Marie — est conçu affecté du péché originel (concile de Trente, Ds 1511-1516). C’est un dogme de foi que l’homme atteint du péché originel ne peut, par ses forces naturelles, ni mériter la grâce ni l’obtenir par la prière, ni s’y disposer positivement (Ds 374, 376 ; Ds 1525 ; Ds 1553). C’est enfin un dogme de foi que, à compter de la promulgation de la loi évangélique, le baptême est nécessaire pour le salut éternel de tout homme, d’une nécessité de moyen (Ds 903, 1314 et 1348).
7.C’est un dogme de foi qu’aucune action de l’homme ne peut l’orienter vers la vie éternelle sans une grâce intérieure à l’âme (concile de Trente, Ds 1525). C’est un dogme de foi qu’un acte de foi surnaturelle est nécessaire pour que l’adulte soit justifié (concile de Trente, Ds 1532).
8.C’est un dogme de foi que Jésus-Christ, en tant qu’homme, est roi (symbole de Nicée-Constantinople. Pie XI, Quas primas, Ds 3675 et passim). Il est plus précisément roi de toutes les nations (c’est-à-dire des cités, ou Etats) : cette proposition n’est pas un dogme de foi, mais elle appartient à la doctrine catholique (Pie XI,Quas primas, Ds 3679 et passim}. Cette doctrine affirme aussi que l’Etat est indirectement subordonné à l’Église (Pie IX, Syllabus, Ds 2924. Léon XIII, Immortale Dei. Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 60, a. 6, ad 3).
Le laïcisme, en tant qu’il prône la non-confessionnalité de la société civile, s’écarte gravement de la vérité (Pie XI, Quas primas). En outre, “qu’il faille séparer [la Cité] de l’Eglise, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur” (saint Pie X, Vehementer nos).
9.“La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres” (Dignitatis humanœ, chap. I, n° 2) : cette proposition de Vatican II est une erreur grave (Pie IX, Quanta cura. Léon XIII, Immortale Dei et Libertas præstantissimum).
10. La matière éloignée du sacrement de confirmation est le saint chrême. Selon l’opinion commune des théologiens, l’huile servant à la confection du saint chrême doit être de l’huile d’olive. L’utilisation d’une autre huile rend donc douteuse la validité de la confirmation. Or, en dehors du cas de nécessité, il n’est jamais licite d’utiliser, pour les sacrements, une matière douteuse. Par conséquent, le canon 847 (§ 1) du code de droit canonique de 1983, en ce qu’il autorise le ministre à se servir, pour l’administration des sacrements, d’huiles fabriquées à partir d’autres plantes que l’olive, n’a pas force de loi.
11. C’est un dogme de foi que la messe est un vrai et propre sacrifice (concile de Trente, Ds 1751), et que ce sacrifice est propitiatoire, c’est-à-dire propre à satisfaire pour les offenses à Dieu (concile de Trente, Ds 1743). Par ailleurs, le Novus Ordo missae de Paul VI (3 avril 1969) “s’éloigne de façon impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte messe” (cardinaux Ottaviani et Bacci, Bref exame critique du nouvel Ordo Missœ, “Préface”) et ne satisfait pas aux conditions d’un culte catholique licite, du point de vue du ministre comme du point de vue du fidèle.
12. Le canon 1095 (§ 2 et 3) du code de 1983 définit des causes d’incapacité au mariage douteuses. Il n’est donc pas permis de s’appuyer sur ces causes pour juger nul un mariage (Cor Unum, n° 61, octobre 1998).
13. Les canonisations postérieures à 1969 sont faites dans des circonstances qui en rendent douteux le bien-fondé. C’est pourquoi l’on ne peut pas adopter les fêtes introduites par le Saint-Siège depuis l’instauration du missel de Paul VI.
14. Dieu s’est révélé à nous et se fait connaître par la foi. Or la foi vient de la prédication, fides ex auditu (Rom 8,17). Donc Dieu se révèle à nous par la prédication. Or nous connaissons la vérité par composition et division. Donc Dieu adapte sa révélation à notre mode humain de connaître. Or la prédication est un discours sur les vérités à
croire, en particulier les mystères. Donc Dieu se révèle à nous par un discours sur les vérités à croire pour être sauvé. Saint Thomas explique (Somme, II-II, q1 a2) que l’objet de la foi, Dieu, est incomplexe du côté de Dieu auquel nous croyons, mais complexe du côté du croyant.
15. Sur l’intelligence du dogme et le développement des énoncés doctrinaux sur notre foi, selon saint Vincent de Lérins cité par le premier concile du Vatican (DB 1800), le progrès doit être admis dans « l’intelligence ou la compréhension » de la Tradition, et même dans un sens bien déterminé.
16. L’Église ne tend pas à la plénitude de la vérité, elle tend plutôt à la plénitude de l’intelligence de cette vérité. La révélation divine, le dépôt de la foi, est en effet clos depuis la mort du dernier apôtre.
17. Admettre la défaillance de quelques actes de l’autorité dans l’Eglise n’est pas nier l’indéfectibilité de l’Eglise.
L’indéfectibilité est le propre de l’Eglise, qui se définit elle-même comme une société. Pas plus qu’une société ne s’identifie formellement à l’autorité qui en dirige les membres, l’Eglise ne se réduit-elle à la Papauté.
L’indéfectibilité de l’Eglise est donc fondamentalement l’indéfectibilité du triple lien de l’unité de profession externe et publique de foi et de culte, dans la soumission au gouvernement hiérarchique divinement institué. Cette indéfectibilité de l’Eglise, prise dans ce triple lien de son unité, peut ne pas toujours aller de pair avec l’indéfectibilité de l’autorité, prise dans l’exercice de ses actes : l’histoire est là pour le montrer.
Autre est l’indéfectibilité de l’Eglise, autre celle de la Papauté, c’est-à-dire de l’autorité suprême dans l’Eglise, autre encore celle de l’exercice de la Papauté, ou de tous et chacun de ses actes, indéfectibilité qui n’est nullement affirmée dans les sources de la Révélation. Car il y a une distinction bien réelle entre d’une part l’institution même de l’Eglise, qui est une institution divine et donc indéfectible, et d’autre part les actes des hommes qui représentent cette institution.
Il n’est pas théologiquement impossible, par conséquent, que l’exercice de l’autorité ne soit pas à la hauteur ni du principe même de l’autorité ni du bien commun réclamé par l’Eglise. Celle-ci demeure indéfectible, par la grâce de Dieu et malgré la faiblesse ou même l’iniquité des hommes, même si l’exercice de la Papauté ne l’est pas toujours.
Car le Pape n’est pas infaillible en tous et chacun de ses actes. L’infaillibilité éventuelle d’une réforme liturgique doit s’entendre toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire à condition que le rite promulgué ne contredise pas, dans sa teneur de rite, le rite déjà promulgué jusqu’ici par un autre acte infaillible, antérieur, de la même autorité papale. Il y a là la règle indubitable du critère négatif, énoncée par saint Paul dans son Epître aux Galates 21 : « S’il arrivait que nous-même ou un ange du ciel [si nos aut angelus de cælo] vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu’il soit anathème »
18. « (…) le latin cultive, mûrit, perfectionne les principales facultés intellectuelles et morales ; il aiguise l’intelligence et le jugement ; il rend l’esprit de l’enfant plus à même de bien comprendre toutes choses et de les estimer à leur juste valeur ; il apprend enfin à penser ou à s’exprimer avec méthode. Si l’on pèse bien tous ces mérites, on comprendra facilement pourquoi les Papes, si souvent et abondamment, ont non seulement exalté l’importance et l’excellence du latin, mais en ont prescrit l’étude et l’usage aux ministres sacrés de l’un et l’autre clergé, et ont dénoncé clairement les dangers qui découleraient de son abandon. (…) Le latin est la langue vivante de l’Eglise ». Jean XXIII, Constitution apostolique « Veterum sapientia », 22 février 1962
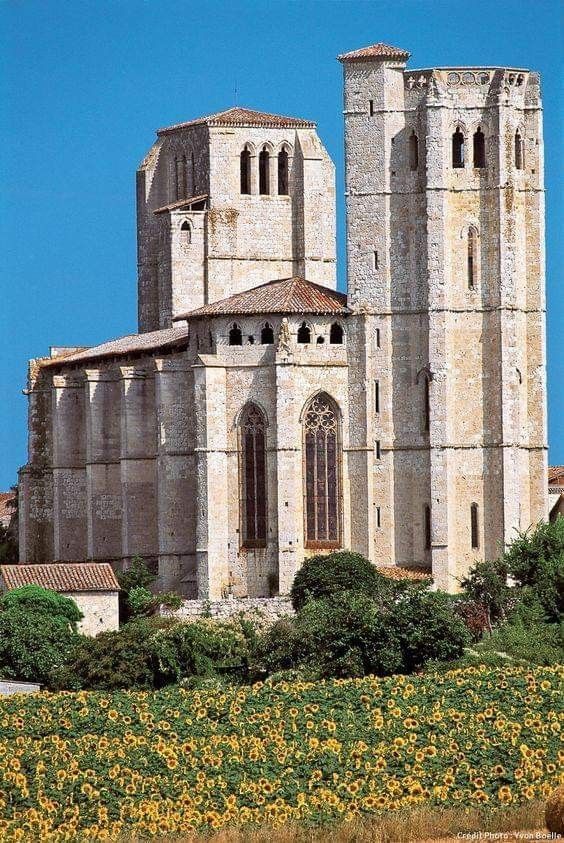
Commentaires